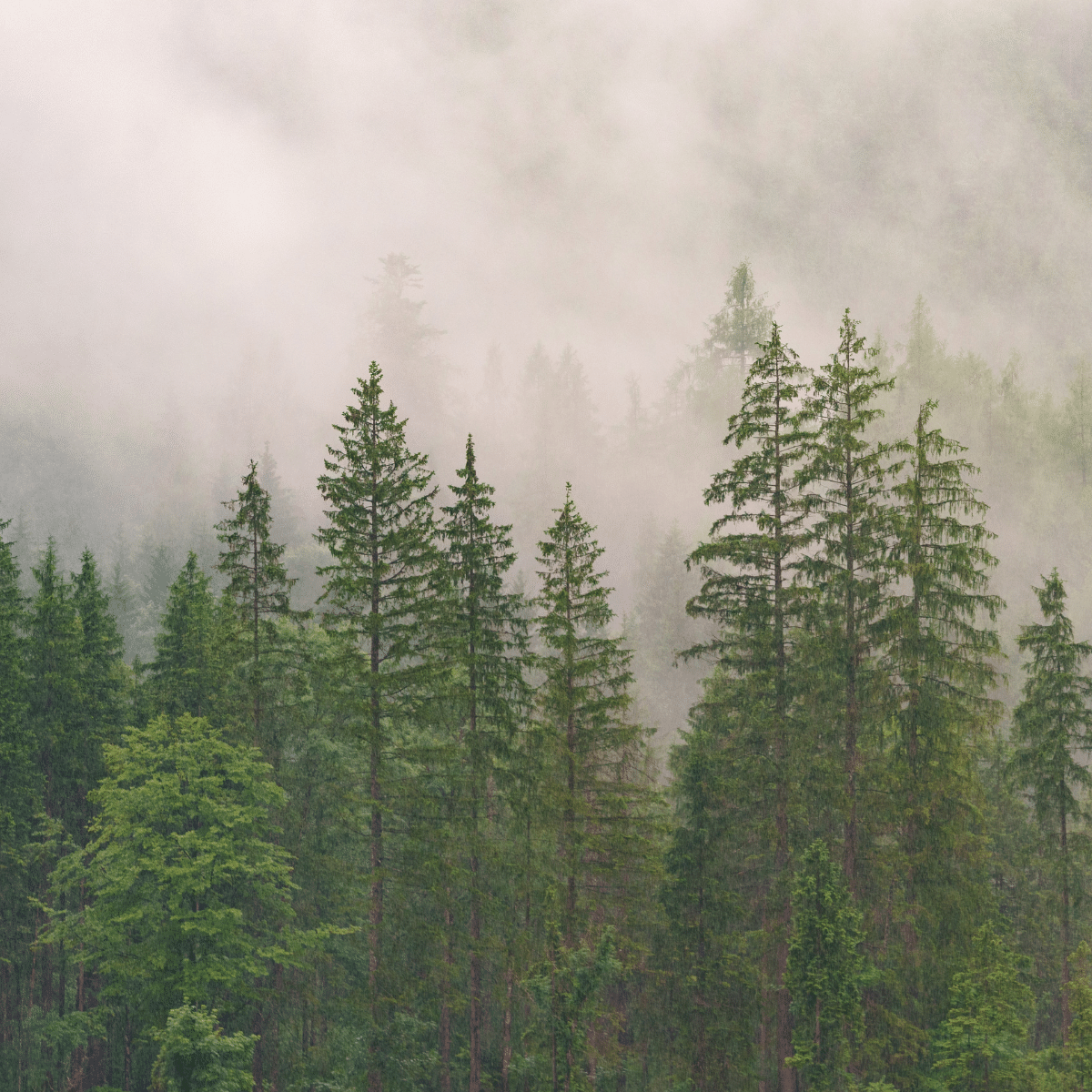
Introduction
Pour de nombreux peuples autochtones et communautés locales d’Afrique de l’Est, la promesse de marchés du carbone justes et équitables reste hors de portée. L’exclusion historique et l’absence de garanties ont trop souvent laissé les groupes vulnérables sur la touche, sans voix au chapitre quant à la répartition des bénéfices. Les intermédiaires empochent les profits : les courtiers achètent souvent le crédit carbone aux propriétaires fonciers à bas prix et les revendent aux acheteurs à un prix beaucoup plus élevé, ne laissant aux communautés qu’une infime partie des revenus générés.
Le Mécanisme de déploiement d’experts – Action climatique en Afrique (EDM-ACA) travaille avec des partenaires pour changer cette situation. Guidées par des principes internationaux tels que le consentement libre, préalable et éclairé, et les garanties de Cancún de la CCNUCC [1] visant à respecter les droits des communautés locales, de nouvelles conversations sont possibles grâce à des lignes directrices et des connaissances qui garantissent que le commerce du carbone respecte les droits des communautés, protège les moyens de subsistance et amplifie les voix locales. Ce travail, demandé par la Coalition africaine des défenseurs des droits humains, s’inscrit dans un mouvement plus large visant à placer les droits humains au cœur de l’action climatique. Pour en savoir plus sur le projet MDE-ACA, cliquez ici.
Protéger les droits dans le cadre du commerce du carbone : défendre les communautés autochtones en Afrique subsaharienne
Contexte
Les marchés du carbone forestier ou les mécanismes de marché tels que définis à l’article 6 de l’accord de Paris de la CCNUCC peuvent faire partie de la solution pour protéger les ressources naturelles grâce à des paiements climatiques basés sur les résultats, mais seulement si les droits de ceux qui dépendent des zones forestières et y vivent sont dûment reconnus et protégés. À l’heure actuelle, il n’existe pas de définition internationalement acceptée des droits liés au carbone, et très peu de pays ont adopté des définitions dans leur système juridique national. Comme ils concernent le droit d’échanger du carbone, le droit de posséder des terres/des droits fonciers ou des ressources forestières, les droits liés au carbone doivent être déterminés par des dispositions législatives et/ou contractuelles. Les pays d’Afrique de l’Est se tournent vers les marchés pour accéder au financement climatique afin de soutenir la gestion durable des ressources forestières tout en améliorant les avantages tirés des forêts en matière de développement et de moyens de subsistance des communautés vulnérables. Cependant, les expériences en cours ont montré que les projets carbones ont violé les droits des communautés vulnérables, dont beaucoup n’ont pas été incluses dans les discussions sur la nature des projets carbone et, par conséquent, ne comprennent pas leurs droits et leurs responsabilités. Dans certains cas, certaines communautés ont perdu leurs terres et leurs vies.[2] (Afin de protéger les participants de cet atelier, nous n’avons pas partagé les noms ou les photos.)
Par Deb Ingersoll, Animatrice Oxfam and Sekai Ngarize, Conseillère en foresterie MDE-ACA
Ces dernières années, le commerce du carbone s’est imposé comme un outil puissant dans la lutte mondiale contre le changement climatique. En permettant aux pays et aux entreprises de compenser leurs émissions grâce à des investissements dans les forêts, les zones humides et d’autres puits de carbone, ces marchés sont très prometteurs pour la protection de l’environnement. Mais sous la surface se cache une réalité complexe : pour les peuples autochtones et les communautés locales d’Afrique subsaharienne, la croissance rapide des marchés du carbone peut également entraîner de nouveaux risques.
Sans garanties adéquates, les communautés qui vivent depuis des générations en harmonie avec leurs terres risquent d’être mises de côté, leurs droits bafoués et leurs voix ignorées au nom de la « lutte contre le changement climatique ». C’est pourquoi un nombre croissant de défenseurs des droits humains, d’avocats et de leaders locaux travaillent sans relâche, souvent au péril de leur vie, pour garantir que les accords sur le commerce du carbone protègent les communautés vulnérables plutôt que de les exploiter.
L’article 6.1 de l’Accord de Paris[1] décrit des approches coopératives, notamment des mécanismes marchands et non marchands, visant à aider les pays à atteindre leurs objectifs climatiques. Cependant, à mesure que les marchés du carbone se développent, en particulier au-delà des frontières, il devient de plus en plus nécessaire de disposer d’orientations claires pour garantir que les communautés vulnérables vivant à proximité des forêts, souvent composées de femmes dont les moyens de subsistance dépendent de la forêt, puissent accéder à des mécanismes équitables de partage des bénéfices. De nombreux projets de carbone forestier sont situés sur des terres traditionnellement utilisées par les peuples autochtones et les communautés locales, dont les droits sont souvent non protégés, ce qui souligne l’urgence de mettre en place une gouvernance plus forte et des cadres équitables.
Pour relever ces défis, les réseaux de défenseurs des droits humains en Afrique de l’Est renforcent les capacités des défenseurs locaux afin de soutenir les communautés autochtones et locales. La Coalition des défenseurs des droits humains mène des efforts de sensibilisation aux droits des communautés autochtones et locales dans les accords sur le commerce du carbone dans six pays africains, par exemple en élaborant des lignes directrices/documents d’orientation sur le partage des bénéfices adaptés au contexte juridique et politique de chaque nation. Ces lignes directrices s’aligneront sur les garanties de Cancún de la CCNUCC[2] et respecteront le principe du consentement libre, préalable et éclairé (FPIC), garantissant que les initiatives d’échange de quotas d’émission de carbone respectent les droits des communautés et favorisent les avantages sociaux et environnementaux.
Un point tournant au Kenya
Au début de l’année, à Mombasa, au Kenya, 17 défenseurs des droits humains venus de toute l’Afrique orientale et australe se sont réunis pour participer à un atelier unique organisé par le Mécanisme de déploiement d’experts – Climate Action Africa (EDM-CAA) et les équipes d’Oxfam. Beaucoup d’entre eux étaient des chefs autochtones, des dirigeants d’organisations locales, des avocats et des défenseurs qui consacrent leur vie à soutenir les peuples autochtones et les communautés locales. Ils se sont réunis dans un seul but : acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour défendre leurs communautés contre des accords de commerce du carbone mal négociés, injustes et inéquitables.
Les principales préoccupations soulevées par les défenseurs des droits humains portent sur l’exclusion persistante des peuples autochtones et des communautés locales (IPLC) des accords de commerce du carbone. Ces accords ne font souvent pas l’objet de consultations inclusives avec les parties prenantes et ne fournissent pas aux IPLC les informations nécessaires pour comprendre ce qu’ils signent. Les barrières linguistiques, telles que les contrats rédigés uniquement en anglais sans service de traduction, entravent encore davantage une participation éclairée. Les communautés se voient souvent refuser l’accès à des mécanismes de réclamation lorsque leurs droits fonciers sont violés, et il n’existe aucune directive systématique pour former les dirigeants locaux à la surveillance, à la notification ou à la défense du partage des bénéfices. En outre, l’absence de terminologie culturellement pertinente, telle qu’une traduction claire du terme « carbone » en swahili, souligne la nécessité de disposer d’outils de communication plus accessibles et mieux adaptés au contexte local.
L’atelier est né d’une demande urgente d’un groupe de défense des droits humains basé en Afrique de l’Est qui avait constaté de première main les risques auxquels les communautés sont confrontées lorsqu’elles sont approchées par des entreprises cherchant à conclure des accords sur le commerce du carbone. Les participants à l’atelier ont partagé leurs expériences réelles de contrats livrés ou d’entreprises arrivant avec des contrats rédigés dans un langage technique, promettant de l’argent ou des avantages en matière de développement, mais sans tenir compte du consentement, de la participation ou du bien-être à long terme de la communauté.
Les participants ont appris comment fonctionnent les marchés du carbone, les garanties internationales existantes, les mécanismes de règlement des griefs et comment exiger des processus équitables et transparents. Ils ont exploré le principe du consentement libre, préalable et éclairé (CLPE/ FPIC), un élément fondamental des droits des peuples autochtones qui garantit aux communautés le droit de dire « oui » ou « non » aux projets qui ont un impact sur leurs terres et leurs moyens de subsistance. En outre, cela signifie que les communautés sont informées des implications de ces accords et peuvent prendre une décision éclairée qui permet de défendre et de faire progresser leurs droits. Plus important encore, l’un des résultats de la formation est que les défenseurs peuvent identifier les violations découlant du commerce du carbone et sensibiliser le public en renforçant les accords sur le commerce du carbone.
Instaurer la confiance, partager des histoires
Les ateliers de ce type ne se limitent pas à une formation technique. Ils visent également à créer des espaces sûrs où les gens peuvent s’ouvrir, partager leurs expériences et instaurer la confiance au-delà des frontières. À Mombasa, les participants ont eu recours à des exercices créatifs, tels que des déclarations « Je suis » et la création artistique collaborative, pour exprimer leur identité et les défis auxquels ils sont confrontés.
Les histoires qui en ont émergé étaient brutes et puissantes. Pour instaurer la confiance, il faut trouver un équilibre entre le rôle des chefs traditionnels et les systèmes juridiques modernes, mais surtout entre le rôle des chefs traditionnels et les instruments politiques mis en place par les gouvernements pour permettre aux lois coutumières de fonctionner et d’être appliquées au niveau local. Certains participants ont fait part des menaces qu’ils avaient reçues pour s’être opposés à des intérêts puissants. D’autres ont décrit le défi que représente l’équilibre entre le leadership communautaire traditionnel et les pressions des systèmes juridiques modernes. Ces témoignages personnels ont révélé la réalité difficile et souvent dangereuse de la défense des droits des peuples autochtones en Afrique aujourd’hui. Ces échanges ont donné naissance non seulement à une solidarité, mais aussi à l’ébauche d’un mouvement : une communauté de pratique régionale où les défenseurs peuvent se soutenir mutuellement, partager des stratégies et amplifier leur voix sur la scène internationale.
Pourquoi les garanties sont-elles importantes ?
Les enjeux sont considérables. En l’absence de directives nationales claires, les entreprises et les promoteurs de projets peuvent exploiter les failles des cadres de gouvernance défaillants et signer des accords d’échange de quotas d’émission de carbone qui marginalisent les communautés autochtones. Les mécanismes de partage des bénéfices, lorsqu’ils existent, sont souvent injustes ou opaques, ne laissant aux communautés que des promesses non tenues.
Pour contrer cela, les experts des réseaux de défenseurs des droits humains s’efforcent de sensibiliser l’opinion publique et soutiennent l’élaboration de lignes directrices communautaires adaptées à des pays tels que le Kenya, la Somalie, l’Érythrée, l’Éthiopie, la Tanzanie et le Zimbabwe. Ces lignes directrices sont basées sur les garanties de Cancún de la CCNUCC, qui soulignent que les actions climatiques doivent « ne pas nuire » et, dans la mesure du possible, « faire du bien » en apportant des avantages sociaux et environnementaux. Elles défendent également des principes internationaux, tels que le FPIC, garantissant que les peuples autochtones et les communautés locales ne soient pas des bénéficiaires passifs des initiatives climatiques, mais des décideurs actifs.
Ces mesures ne sont pas de simples cases à cocher bureaucratiques. Elles constituent la première ligne de défense des communautés locales dont la survie culturelle, les droits fonciers, la gestion écologique et les moyens de subsistance dépendent de protections solides et doivent être respectés dans toute solution au changement climatique.
Des histoires qui inspirent le changement
Des groupes tels que la Coalition africaine des défenseurs des droits humains ont sensibilisé le public aux droits des peuples autochtones et des communautés locales dans les accords sur le commerce du carbone en dénonçant les violations des droits humains dans ces accords et en plaidant pour la participation des communautés et leur autonomisation grâce à des connaissances sur leurs droits fonciers. Le travail de plaidoyer mené par les défenseurs a contribué à renforcer la résilience collective des communautés qui se trouvent en première ligne tant sur le plan des droits humains que de l’action climatique.
Ce qui rend ces initiatives si efficaces, ce n’est pas seulement les connaissances transmises, les compétences acquises ou la meilleure compréhension des cadres politiques, mais aussi les histoires des personnes impliquées :
- Une femme qui défend ses terres ancestrales contre un accord d’échange de quotas d’émission de carbone auquel elle n’a jamais consenti.
- Un jeune avocat qui risque sa sécurité pour représenter une communauté rurale devant les tribunaux.
- Un réseau d’activistes qui utilise des groupes WhatsApp pour partager des informations urgentes au-delà des frontières.
Ces histoires humaines mettent en lumière les enjeux et expliquent pourquoi il est si crucial de renforcer la gouvernance du marché du carbone en intégrant des garanties sociales et environnementales dans les accords d’échange de quotas d’émission. Elles nous rappellent que l’action climatique ne peut se faire au détriment des droits humains et d’une bonne gouvernance environnementale. Au contraire, les deux doivent aller de pair pour que les solutions soient véritablement durables.
« Nous bénéficions ici d’une facilitation et d’un renforcement des connaissances très complets sur un sujet que nous ne connaissons que de manière très superficielle. Je suis très reconnaissante de me sentir aussi responsabilisée dès le premier jour. Nous avons la meilleure équipe de facilitation qui soit, qui s’adresse à un groupe de défenseurs des droits humains et de la justice environnementale à la fois passionnés et très diversifiés. Puissent les connaissances que nous acquérons continuer à nourrir notre engagement en faveur de communautés prospères. » – Participante au programme Human Defenders
Perspectives d’avenir
Les ateliers comme celui du Kenya constituent un pas en avant, mais il reste encore beaucoup à faire. L’élaboration de lignes directrices nationales solides, la création de réseaux régionaux de défenseurs et l’amplification de la voix des leaders autochtones sont autant d’éléments essentiels pour l’avenir. La justice climatique ne doit pas se limiter à la réduction des émissions. Il s’agit également de transférer le pouvoir et, surtout, de renforcer les voix qui comptent le plus. La protection des droits dans le cadre du commerce du carbone est une tâche complexe et difficile, souvent sous-financée. Mais elle est également essentielle, car au cœur de la lutte contre le changement climatique se trouvent des personnes dont la vie, la culture et la dignité ne doivent jamais être sacrifiées au nom du progrès. L’assistance technique fournie par la CAA visait à promouvoir la mise en place de meilleures structures de gouvernance pour les pays et les communautés locales participant aux initiatives des marchés du carbone.
« La justice climatique commence lorsque le consentement, la culture et la communauté sont considérés comme non négociables. La justice doit être au cœur de chaque transaction climatique. » – Participant au programme Human Defenders
Le défi consiste désormais à faire en sorte que cet intérêt se traduise par de réelles opportunités pour les peuples autochtones et les communautés locales. Cela signifie que les résultats de l’assistance technique doivent plaider en faveur du partage des bénéfices du commerce du carbone avec les communautés vulnérables, notamment les femmes et les jeunes. L’amélioration de la gouvernance dans le commerce du carbone et la promotion de la responsabilité incombent aux chefs traditionnels et aux gouvernements locaux, qui doivent veiller au bien-être et aux ressources naturelles des communautés locales.
Sources:
[1] https://www.un-redd.org/document-library/advancing-redd-module-3-redd-safeguards-under-unfccc
[2] https://www.wunc.org/2024-04-11/journalist-says-a-land-grab-in-tanzania-is-forcing-the-maasai-off-their-land
[3] https://easternafricaalliance.org/download/article-6-negotiations-handbook-for-eastern-africa/



